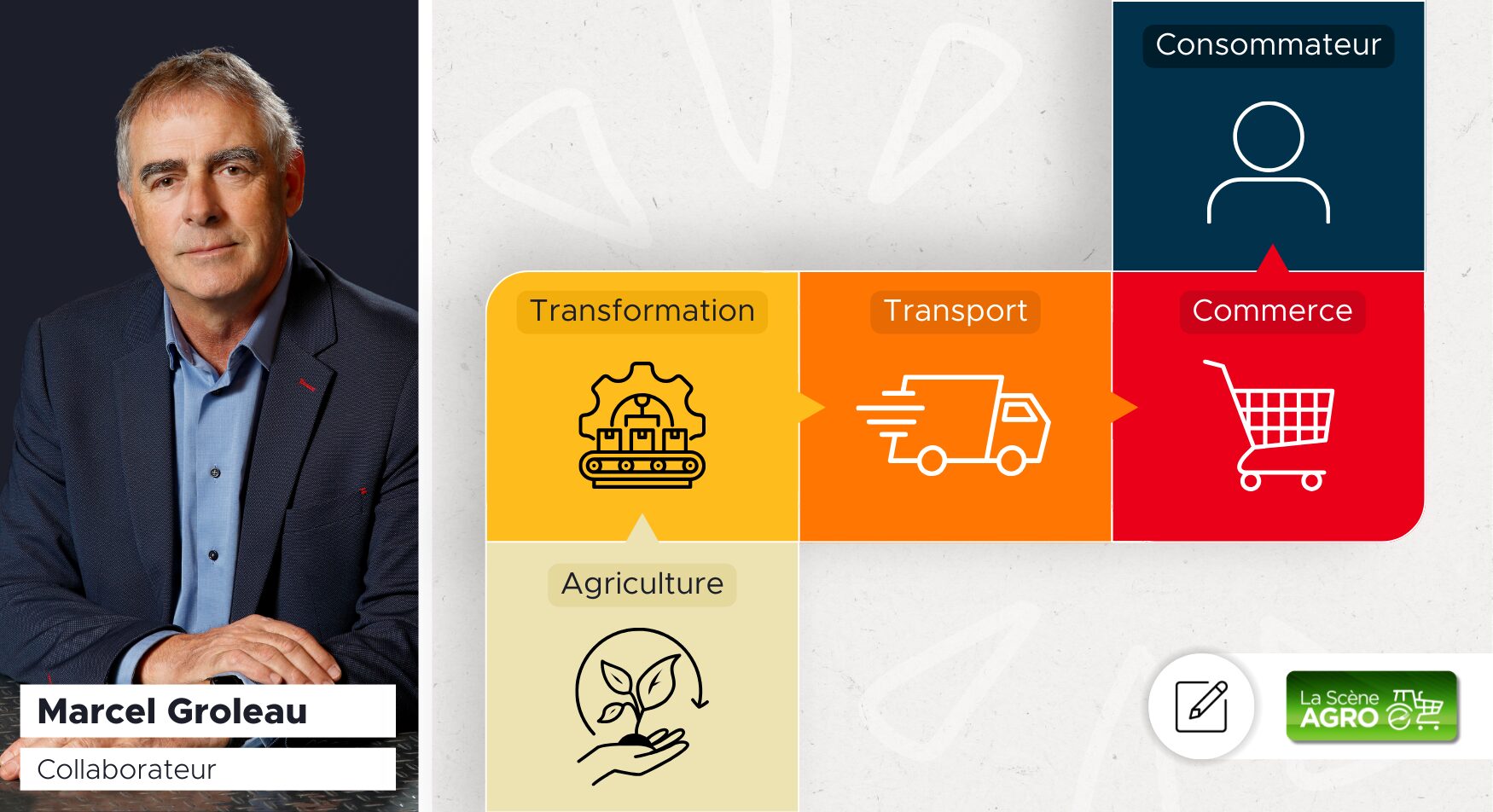
Partager
Temps de lecture
8 minutes
J’ai vraiment apprécié mon dernier séjour en France. Une visite en France, surtout en Bretagne et en Normandie, permet de remonter le temps, d’imaginer le départ des premiers Français vers la Nouvelle France à l’origine de la fondation d’un nouveau pays, d’un peuple francophone en Amérique du Nord. Les nombreux monuments, cathédrales et châteaux témoignent de la puissance et de la richesse incroyable de la France à une certaine époque. N’eut été des problèmes politiques de la couronne française au 18ème siècle, qui sait ce que serait devenu le Canada et l’Amérique du Nord.
Mon passage à L’académie d’Agriculture de France a été fort intéressant. J’ai été très heureux de rencontrer les membres de l’Académie et de recevoir la médaille de Vermeil des mains de la présidente Marion Guillou. J’y allais aussi pour présenter les travaux de la Coalition Nourrir l’humanité durablement que je préside. La coalition compte près de cent organisations membres. Elle milite pour un accès à des aliments de qualité, accessibles pour tous et produits de façon durable. La Coalition travaille étroitement avec la Chaire de recherche en droit sur la sécurité et la diversité alimentaires de l’Université Laval, qui a d’ailleurs produit une convention en droit sur la sécurité et la diversité alimentaire qui vise à créer un contrepoids aux forces économiques qui priment actuellement dans les ententes commerciales. Cette convention a pour objectif d’accorder aux nations plus de flexibilité et de pouvoir pour exercer leur souveraineté alimentaire.
La présentation a donc soulevé plusieurs questions, ainsi qu’une discussion animée sur l’enjeu de la sécurité et de la souveraineté alimentaire. Les enjeux de souveraineté et d’autonomie alimentaires sont très présents dans l’actualité française alors que débat est ouvert concernant la signature d’un accord commercial entre l’Europe et le Mercosur. L’Italie, l’Autriche et quelques autres pays européens s’opposent également à la signature de cet accord commercial mais le train de la mondialisation cherche toujours à avancer.
Le commerce agricole et alimentaire mondial est essentiellement régulé par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et les failles de cet accord, concernant l’agriculture, sont de plus en plus évidentes. De plus en plus de gens, dont un groupe d’experts de l’ONU réunis au sein de l’IPBES, soit la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, remettent en question le système alimentaire mondial. En effet, mettre en compétition les agricultures du monde, produites sous des climats très différents, sans exigences communes sur des normes sociales et environnementales, créent des distorsions commerciales énormes, en plus de mettre une pression insoutenable sur les ressources naturelles, l’environnement et la biodiversité.
La souveraineté alimentaire des nations est subordonnée aux obligations qu’elles ont contracté via leur adhésion aux ententes multilatérales commerciales. C’est le cas pour les pays signataires de l’OMC, pour la France dans l’Union européenne, tout comme pour le Canada à travers les nombreux accords que nous avons signés. Ces ententes sont importantes, mais pour que les pays puissent réellement exercer leur souveraineté alimentaire, un recadrement du commerce agricole et alimentaire mondial est nécessaire. La convention en droit sur la diversité et la sécurité alimentaire à laquelle j’ai fait référence plus haut est certainement une option en ce sens.
J’ai eu l’occasion d’aborder ces questions avec Alain Mouligner, vice-président du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux. Ce groupe sur lequel siège Alain Mouligner agit en tant qu’instance-conseil auprès du ministre de l’Agriculture. Le conseil est présidé par le ministre de l’agriculture lui-même. J’étais curieux d’entendre ses explications suite au changement de nom du ministère. En effet, suite à la pandémie, le ministère de l’Agriculture français est devenu le Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt.
Le nouveau vocable est une indication des inquiétudes et de la volonté de l’État Français par rapport à l’avenir de son agriculture et de son alimentation. Le secteur agricole français fait face à une concurrence de plus en plus importante, tant à l’intérieur de l’Europe qu’au sein du marché mondial. Les fermes françaises sont de petites tailles comparées au modèle allemand et hollandais. Les pays de l’Est qui ont rejoint l’Europe sont de plus en plus compétitifs et leurs coûts de production sont plus bas.
La France, qui avait misé sur les appellations d’origines et sur une production agricole de terroir, lors de la création de l’OMC, peine à maintenir ses positions sur les marchés, malgré le généreux soutien de l’État dont bénéficient les producteurs français. Ce soutien est trois fois plus important que ce que reçoivent les agriculteurs canadiens. L’Europe et la France étaient d’ardents promoteurs de l’accord de l’OMC et de la libéralisation du commerce agricole. Cette position semble maintenant beaucoup plus mitigée, du moins en France.
Idéalement, tous les pays devraient viser le maximum d’autonomie alimentaire et avoir la flexibilité d’adopter les politiques appropriées. Ce principe, pourtant simple, ne cadre pas avec la logique des ententes commerciales multilatérales. Le commerce agricole est essentiel, mais il ne devrait pas se faire au détriment des agricultures locales, via la surexploitation des ressources naturelles de certains pays exportateurs. Il est très risqué que la sécurité alimentaire mondiale repose essentiellement sur le bon fonctionnement des réseaux internationaux d’approvisionnement agricole et alimentaire. Nous avons vu l’impact sur les prix des aliments et des intrants agricoles lors d’évènements majeurs tels que la pandémie de Covid-19 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
Ajoutons à cela, les risques importants que font courir la crise climatique sur la productivité agricole, le déclin de la biodiversité partout sur la planète, et l’exploitation excessive des ressources naturelles que sont l’eau douce et les terres arables. Les probabilités de voir émerger dans l’avenir des crises alimentaires augmentent réellement. Le principe de précaution est de mise et des gestes concrets comme le recadrement des règles commerciales pour l’agriculture et l’alimentation devraient être posés dès maintenant.
Pour conclure, je remercie l’Académie d’Agriculture de France pour les beaux et fructueux échanges que nous avons eus et pour les belles rencontres. Je vous laisse sur les mots de Jean Louis Rastoin, membre de l’Académie, alors qu’il citait Jean Anthelme Brillat-Savarin pour conclure une session de travail sur la précarité alimentaire.
« La destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent » (Physiologie du goût, 1825).
Cette prophétie est encore d’actualité.