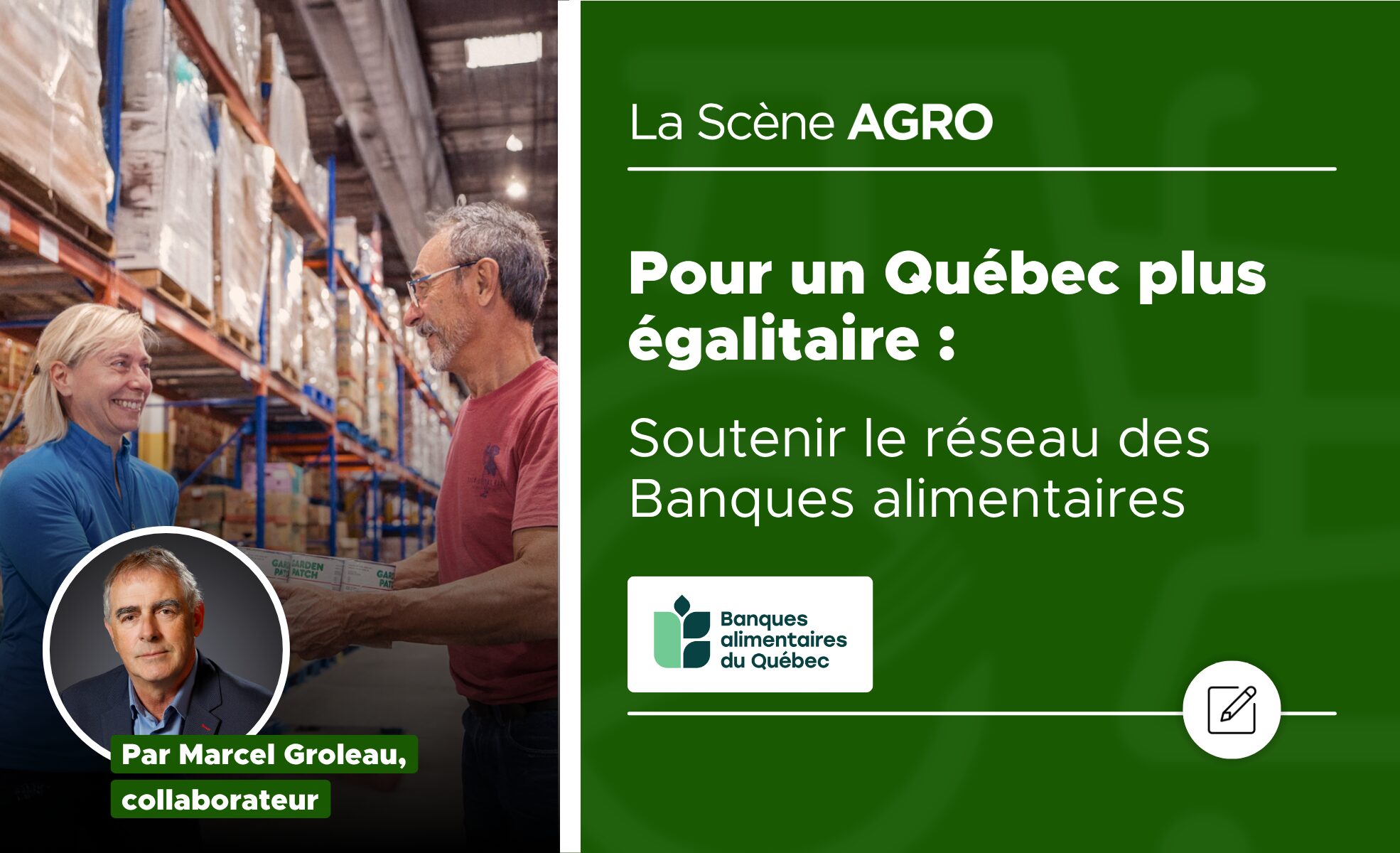
Lorsque j’ai quitté la présidence de l’UPA, j’ai rejoint le conseil d’administration de Banques alimentaires du Québec (BAQ). Durant mes années à la présidence des Producteurs de lait du Québec puis de l’UPA, j’avais eu l’occasion de collaborer avec BAQ, notamment par le biais du programme de don de lait. Ce programme unique permet aux producteurs, individuellement, d’offrir un volume de lait qui est transporté et transformé gratuitement, assurant ainsi à BAQ un approvisionnement prévisible en produits laitiers. J’ai également participé à une importante campagne de levée de fonds menée de 2017 à 2020, qui a permis d’amasser plus de 11 millions de dollars pour la mise en place du Programme de récupération en supermarchés (PRS).
J’ai toujours été très sensible aux questions d’insécurité alimentaire et à la valeur des aliments. Mes parents, nés au tournant des années 1920, nous ont appris le prix réel de la nourriture et l’importance de ne rien gaspiller. Aujourd’hui, on estime pourtant que 25 % de la nourriture produite est gaspillée, alors qu’une personne sur huit a recours à l’aide alimentaire. D’un point de vue éthique et environnemental, c’est tout simplement inacceptable.
L’insécurité alimentaire au Québec : un phénomène en croissance
L’insécurité alimentaire touche un nombre croissant de personnes. Le 27 octobre dernier, BAQ a publié le Bilan Faim 2025. Au total, 1 393 organismes communautaires affiliés au réseau des Banques alimentaires du Québec — accrédités et desservis par les 18 Moissons membres et les 15 membres associés — ont répondu à un sondage permettant de comparer les données de mars 2025 avec celles des années précédentes. La méthodologie en fait un portrait rigoureux.
Selon le Bilan, le réseau a répondu à 3,1 millions de demandes d’aide alimentaire, une hausse de 6 % par rapport à 2024 et de 55 % depuis 2022. On croyait qu’après la pandémie, la situation s’améliorerait et que le recours à l’aide alimentaire diminuerait. Ce ne fut pas le cas.
La flambée des coûts d’habitation, la hausse des taux d’intérêt post-pandémiques, l’inflation du prix des aliments et la précarité de l’emploi ont fragilisé les ménages, tout particulièrement les plus vulnérables. Les données les plus récentes de Statistique Canada indiquent que 15,7 % de la population québécoise vit dans un ménage en situation d’insécurité alimentaire : plus d’une personne sur huit. La situation est similaire dans le reste du Canada.
Pourtant, le Québec a connu une forte croissance économique après la pandémie. Tous n’en ont pas profité, l’écart entre les plus riches et les plus pauvres ne cesse de se creuser. Les 20 % les mieux nantis ont vu leurs revenus augmenter de façon importante entre 2020 et 2024, alors que les 20 % les plus pauvres ont vu les leurs diminuer, selon Revenu Québec. C’est un signe inquiétant d’une société qui devient de moins en moins égalitaire. La classe moyenne s’effrite, et le filet social n’est plus ajusté aux réalités économiques actuelles. Les conséquences sont bien réelles : les enfants représentant le groupe le plus important de bénéficiaires de l’aide alimentaire. C’est profondément préoccupant.
Banques alimentaires du Québec : un rôle essentiel pour la sécurité alimentaire
Heureusement, BAQ et les Moissons sont là. Leur travail repose sur la générosité des Québécois et, surtout, des entreprises du secteur agroalimentaire. Les fédérations de producteurs agricoles (comme le rappelle l’édito de Martin Caron), de même que les transformateurs et les distributeurs alimentaires, répondent toujours présents. Parmi les programmes les plus innovants, le Programme de récupération en Super marché se démarque (PRS) : l’an dernier, il a permis de récupérer plus de 10 millions de kilos de denrées dans 680 épiceries — autant de nourriture qui n’a pas terminé au compostage.
Pour l’exercice 2024-2025, BAQ et le réseau des Moissons ont distribué 46,8 millions de kilos de denrées, pour une valeur estimée à 348 millions de dollars. Les Québécois sont généreux : seulement 8 % de cette nourriture provient d’achats rendus possibles grâce à l’aide financière de l’État.
L’insécurité alimentaire n’est pas qu’un phénomène urbain. Comme l’itinérance, elle touche toutes les régions du Québec. Le réseau repose sur le travail de centaines de bénévoles qui, devant l’ampleur de la tâche, montrent parfois des signes d’essoufflement. Vos dons sont leur principale source de motivation et de reconnaissance.
N’oublions jamais qu’une stabilité sociale durable est impossible sans un solide filet de sécurité alimentaire. À l’approche du temps des fêtes, nous sommes naturellement plus sensibles à la misère humaine et plus enclins à donner. Mais les besoins sont présents tout au long de l’année. Pour une société plus juste et plus égalitaire, restons solidaires du réseau de BAQ.
Joyeuses Fêtes!
Partager
Temps de lecture
11 minutes
Bravo que des gens sérieux et avec du fort potentiel fassent réellement ce qui est à faire et voient aux besoins pour aller au-devant.
Bravo vraiment à Marcel Groleau.
Lâchez- pas et que des jeunes nouveaux vous accompagnent (presque autant vaillant et passionnés).
Bonne continuité!